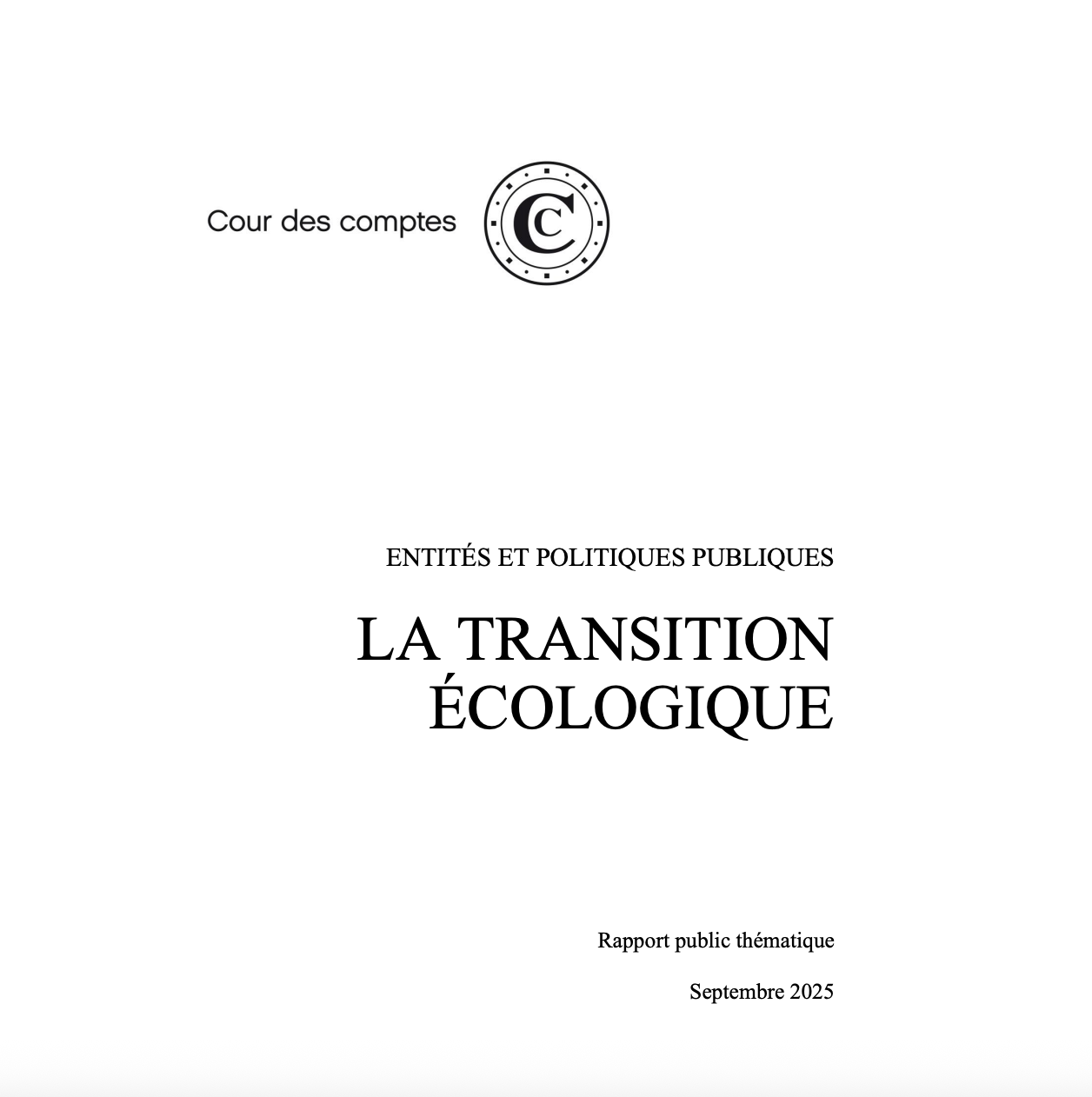La Cour des comptes a publié ce 16 septembre 2025 son premier rapport public annuel consacré à la transition écologique. Plusieurs Régions avaient été auditionnées, ainsi que Régions de France, représentée par Stéphanie MODDE, vice-présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, élue référente pour les politiques d’’adaptation au changement climatique au sein de la commission Transition écologique.
Parmi les principaux constats de ce rapport :
- Le besoin de clarté, de cohérence et de pilotage efficace des politiques publiques de transition écologique et le renforcement du SGPE dans la coordinnation interministérielle de ces politiques sectorielles et dans la définition des stratégies pluriannuelles de financements de la transition écologique,
- la nécessité d’approfondir l’intégration des dynamiques locales dans les COP régionales reconnues comme de véritables avancées, « en tenant compte des spécificités et des contraintes propres à chaque territoire, grâce à un dialogue renforcé entre l’État et les collectivités, des contrats plus opérationnels et des financements pérennes »,
- L’urgence d’une définition claire des priorités entre État et collectivités, une évaluation régulière de l’impact des dispositifs mis en place et une diminution plus importante des dépenses défavorables à l’environnement.
Des constats qui rejoignent les positions portées par Régions de France
Régions de France salue les constats posés par la Cour, qui rejoignent plusieurs alertes déjà formulées par les Régions, notamment :
- « Une insuffisante voire absence de prise en compte des diagnostics préalables et stratégies propres des régions en matière de transition écologique pour établir leur SRADDET »,
- Une insuffisante prise en compte « des efforts déjà réalisés au niveau régional et des stratégies préexistantes », ajoutant que « cette carence a pu provoquer une incompréhension des acteurs locaux qui s’étaient déjà impliqués dans des concertations et groupes de travail régionaux, dont la programmation ne correspondait pas à celle, « à marche forcée », des Cop. »
- Une démarche précipitée et perçue comme descendante : « Alors que ces premières Cop régionales ont été globalement perçues par les acteurs locaux comme un moyen d’apporter de la transversalité à des politiques de transition souvent segmentées, la rapidité de la démarche et le manque d’association de certains acteurs – les intercommunalités par exemple – a pu donner l’impression d’un processus purement descendant, sans lien avec la réalité de terrain et sans considération pour l’action déjà accomplie par les collectivités territoriales. (p.63). Et « Les réunions de lancement de la première édition des Cop, durant lesquelles ont été présentés la démarche et les « panoramas des leviers » ont souvent été vécues comme une opération de communication ministérielle très formelle, organisée trop rapidement. Le calendrier resserré des Cop a souvent été perçu par les exécutifs locaux comme un facteur limitant leur appropriation et entravant les discussions méthodologiques sur les leviers de décarbonation et la construction des feuilles de route. » (p.63)
Autres points d’attention relevés par la Cour
Le rapport aborde également plusieurs sujets structurants pour l’action des Régions :
- Contractualisation et plus spécifiquement la démarche CRTE : la Cour indique que « aucun bilan des CRTE nouvelle génération et de leurs modalités de gouvernance ne peut être tiré à ce jour » au regard des démarches COP qu’ils n’ont pas intégré alors que 849 CRTE ont été signés, selon des formats très hétérogènes tant sur le fond que sur la forme. Au-delà des CRTE, la Cour appelle à une connaissance plus complète des financements déployés en faveur de la transition écologique, y compris les financements propres des collectivités territoriales.
- Dépenses dommageables à l’environnement : la Cour rappelle que le plan de sortie progressive des subventions néfastes à la biodiversité n’est pas connu à ce jour malgré l’engagement de la France le cadre mondial de Kunming-Montréal de 2022 et de la mesure 37 de la stratégie nationale biodiversité (SNB) pour 2030 publiée en 2024.
- Budget vert ou obligation d’annexe environnementale au budget des collectivités (art 191 LFI 2024) : la Cour relève que les collectivités ayant expérimenté les budgets verts depuis 2019 (dont les Régions) n’ont pas opté pour l’approche évaluative retenue par l’Etat (mesurer l’impact environnemental des investissements locaux par une cotation environnementale sur le budget exécuté, annexe au compte administratif et non au budget primitif). Elles ont en effet « utilisé le budget vert comme un outil de pilotage ex–ante pour réorienter les investissements vers des projets plus favorables à l’environnement, en cohérence avec les stratégies et objectifs définis dans leurs documents de planification ».
Vers une meilleure reconnaissance du rôle des Régions
Enfin, la Cour reconnaît explicitement le rôle des Régions comme cheffes de file sur la plupart des volets de la transition écologique, saluant leur capacité à élaborer des stratégies financées et adaptées aux réalités locales.
Régions de France se félicite de cette reconnaissance et appelle à ce que les prochaines étapes de la planification écologique s’appuient davantage sur les dynamiques territoriales déjà engagées, dans une logique de co-construction et de confiance entre l’État et les collectivités.